Natchwey, Nacht Weg
Photographies de guerre de James Natchwey

L’insupportable fait recette. Force est de constater que notre regard s’en repaît. Et que notre raison parvient, au prix de quelques contorsions, à rendre justice d’un tel phénomène.
On ne peut certes pas accuser le photographe d’avoir lui-même commis les atrocités qu’il répercute. Ni accabler un photographe en particulier. Mais Natchwey est emblématique. Il nous conduit, par un chemin de ténèbres – Nacht Weg – jusqu’à une certaine fascination.
Fasciné, le regard voit-il ou dévoie-t-il ce qu’il envisage ?
Une fois le mal en ligne de mire, la question du " point de vue " adopté est essentielle. Depuis Susan Sontag, nous ne le savons que trop, la photographie exige d’abord une éthique du regard non pas de la part du photographe, mais de la part du consommateur d’images, comme le souligne sa diatribe, Devant la douleur des autres (Regarding the pain of others, Farrar, Straus and Giroux, et Bourgois, 2003).
Or, une telle éthique est-elle encore possible dans une exposition de ténèbres humaines peintes par Natchwey ?
S’il est tout à l’honneur de cet homme de s’interroger sur son propre rôle dans la promotion spectaculaire réservée depuis vingt ans aux " témoins oculaires " et aux icônes véristes de la souffrance, reste la question de leur effet sur le grand public, lors de leur diffusion sur les chaînes aux heures de grande audience.
Ce que nous voulons interroger ici, c’est le primat de l’intention pure : on proclame actuellement que Natchwey a une démarche consciente et questionnante sur le mal, et on croit ainsi légitimer ainsi son travail photographique. On pense que ses clichés véhiculeront le même message humaniste qui l'anime en tant qu'homme. Mais il apparaît que c’est tout le contraire qui se produit : le phénomène, beaucoup plus préoccupant, de la curiosité charognarde, appelée " nécrophagie ", induit un tout autre rapport aux clichés d’horreur.
Regardons bien.
Des jarrets consummés dans la boue blanchie d'une paire de tennis fondues; un godet de chantier ivre, balançant au-dessus des charniers; d'innombrables boîtes crâniennes sectionnées affleurant sous les roseaux d'un marais africain; la torsion dantesque du charpentage des Twin Towers; la chambre asphyxiante d'un tireur d'élite croate en pleine action; une veuve écrasée par le poids des morts; un profil cicatrisé, un cadavre, une silhouette broyée par la faim...
Tel était le spectacle accablant auquel nous conviait, par exemple, la Bibliothèque nationale de France, Galerie Mansart, du 29 octobre 2002 au 2 février 2003. Telle sera la redite des prochaines expositions et émissions télévisées qui encenseront James Natchwey : n’a-t-on pas vu L’Humanité le qualifier de " dernier grand romantique " ?
Tel est le propos de celles et ceux qui portent au pinacle ce photographe de guerre: nous représenter l'horreur nue, l'horreur pure, cet absolu d'épouvante où nous devons - car il y a désormais un devoir que l'on assaisonne du nom de lucidité - où nous sommes sommés, donc, de reconnaître le monde dans lequel nous vivons.
Et ce n'est sans doute pas faute de bonne volonté. Il y a même lieu de craindre une forte dose de "bonne volonté" derrière un tel projet... Car Natchwey n'est pas un choix ironique, ni cynique. L'un des responsables de l'exposition ne déclare-t-il pas: "le caractère engagé et profondément humain de la démarche de James Natchwey justifie la dureté de ces images, dont certaines peuvent choquer un public sensible".
Or, qu'est-ce qui nous autorise à croire véritablement "humaine" la démarche de J. Natchwey?
N'est-ce pas surtout le caractère "engagé" de son oeuvre qui devait à tout prix se parer d'un qualificatif plus tendre, plus empreint de respect, ce qui a porté le choix sur le terme "d'humain", équilibrant subtilement l'atrocité ?
Si prévenir avec délicatesse le public trop jeune faisait partie des devoirs du commissaire d'exposition, (et l'affichage à l'entrée faisait cruellement défaut en la matière), on ne peut manquer de s'étonner sur la qualité du public visé: faut-il donc être "insensible" pour assister à une exposition de photographie d'actualité ?
La "sensibilité" devient-elle, curieusement, une tare ? Un défaut de lucidité, qui empêcherait de regarder les choses, les hommes, la vérité "en face" ?
L'implacable logique ambiante qui préside à de telles fausses précautions (où l'on sent la précaution d'usage) ne se laisse pas aisément interroger. Il serait parfaitement vain, d'ailleurs, de demander à quiconque de rendre compte de ce qui a décidé de la nécessité de cet événement artistique, si tant est que l'insupportable constitue réellement un "événement", et ne soit pas, au contraire, l'irrémédiable retour du même, la redite obstinée d'un mal qui n'invente rien, se contentant de réduire à néant la multicolore diversité de l'être.
Lucidité, devoir de mémoire, courage, prévoyance, pédagogie: les motifs d'une semblable entreprise se devaient d'être grands. Mais étaient-ils les seuls ? Rien ne les menace-t-il, au sein même de l'œuvre qui a été choisie pour les défendre ? Nous savons à quelle rhétorique médiatique s'exposerait toute réaction, même timide, à ce totalitarisme de l'insupportable. Qui, d'ailleurs, supporterait sans gémir qu'on lui retire l'occasion de s'arroger un pouvoir sur la représentation du monde ? Et, à l'évidence, de telles photographies n'ont aucunement pour but d'informer, comme le dit si bien leur auteur; elles ont une vertu curative, elles sont censées nous inspirer l'horreur sacrée d'une punition: de même que l'enfant perçoit l'interdiction, le spectateur devrait voir ici, selon le vœu même de Natchwey, "ce qui ne devrait jamais se reproduire".
Mais pas un instant on ne semble avoir douté de la vérité du propos. Pas une seconde ne nous est venu de suspicion à l'égard des pulsions sociales qui consacrent ce genre de photographie.
Peut-être serait-il légitime de remettre en cause la capacité des images - et particulièrement, de celles-ci - à forcer notre espace mental et à tenir lieu d'idées, de pensées, de conceptions, là où elles ne provoquent qu'un sentiment d'horreur et d'impunité devant l'horreur, un effroi, une glaciation. Il serait opportun de mesurer la portée de telles images sur la violence politique des peuples. On ne balance pas impunément à longueur d'année des icônes de catastrophe aux yeux d'une population sans qu'elle voie rouge à la première menace, et s'interdise toute démarche diplomatique qui consisterait à "prendre sur soi". Il serait temps, croyons-nous, de délimiter ce pouvoir, qui en est un, comme il y en eut peu jusqu'ici, ce pouvoir de l'épouvantable, que tous les enfants ont un jour exercé sur leurs camarades en racontant le fait divers horrible, qui allait clouer le bec à tous et provoquer la surenchère, l'appétit de l'horrible.
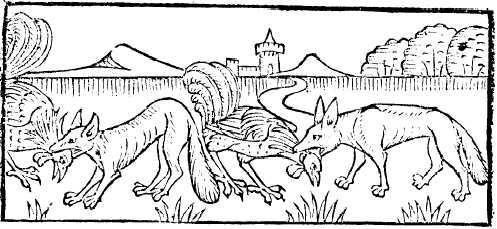
Que Natchwey n'aille donc pas nous en conter sur son intention de guérir les hommes du mal qu'ils font... Etrange cure, en vérité, qui illustre au plus près le mal qu'elle est supposée éradiquer, étrange avertissement d'une esthétique soignée, valorisant ses graves, ses tons ombrés, les contrastes angoissants des peaux et des métaux, des poussières et des saignements, qui les célèbre et les maquille d'un "plus jamais ça".
La litanie presque électrique de ces brutalités, de ces fosses, de ces charognes, a-t-elle d'autre but, véritablement, que de couper le souffle ? Me fera-t-on croire que ce photographe ne prétend pas à l'art lorsqu'il se saisit de ses proies de chair pour les épingler dans son album de collectionneur, le verre à la main, à commenter les holocaustes ? Je n'imagine pas un instant qu'un photographe se serait arrogé cette position moralisatrice et séduisante au lendemain de la Shoah. Les responsables politiques, les administrateurs de la Bibliothèque qui représente le pays, le Président Jeanneney lui-même, qui se félicitait chaudement du succès de son exposition, auraient-ils, s’ils avaient vécu en 1946, organisé l'exposition des Camps au mépris des sentiments encore vifs des survivants ? Je ne crois pas qu'ils s'y fussent risqués. Je pense particulièrement à certaines personnes douées de l'autorité naturelle que leur a conféré l'extermination de leurs semblables, et dont les mots n'auraient pas été assez durs pour dénoncer un voyeurisme drapé dans la bonne conscience du devoir de mémoire. Que les photographies accablantes des exécutions sommaires de Pologne, des files cadavériques et des fosses cauchemardesques d'Auschwitz, couvrent les murs du Centre de Documentation Juive Contemporaine, ce n'est que justice. Que ces images reparaissent dans des émissions consacrées à ce drame, complètes et repérables, que cette horreur soit invoquée contre l'amnésie, c'est l'Histoire qui nous en fait un devoir.
Mais je ne me souviens pas qu'aucune photographie historique de l'holocauste trahisse un souci esthétique, en-dehors bien sûr des mises en scène ourdies par les SS eux-mêmes; nulle part on ne voit de portrait composé d'un de ces inoubliables visages rigides; nulle part on ne constate une telle contiguïté volontaire entre la noirceur des scènes décrites et le noir et blanc de fin du monde d'un pigment soigneusement sélectionné (à quoi tient, ni plus ni moins, le succès stérile de Natchwey, la réussite en matière photographique étant atteinte lorsque les moyens artistiques de la représentation entrent en cohérence avec la scène représentée); nulle part, parmi les reportages stupéfaits des libérateurs de camps en 1945, l'intention ne prime sur le fait.
C'était un temps, de toute évidence révolu, où l'urgence historique suffisait à combler les obturateurs, les nécessités de l'action ne laissant pas le loisir de soigner indûment le cadrage. Derrière les nombreuses photographies de l'armée américaine, comme dans les prises de vue de Nuit et brouillard, une grande austérité se joint à l'absence de manipulation esthétique. On devine que la raison d'être de ces images dépasse de loin le projet personnel, ce qui n'est malheureusement pas le cas du tableau de chasse étrangement professionnel de Natchwey. Mais les raisons d'une telle prise à partie visuelle, d'une telle main au collet, ne se réclament très certainement que du plus noble humanisme...
Donc, tels qu’ils sont actuellement servis aux heures de large audience, les pires sévices corporels nous paraissent de puissantes indignations bienfaitrices. A l'heure d'une prétendue indifférence ambiante, on veut repousser les limites du visible. Nous portons la mauvaise conscience des peuples auxquels il n'arrive rien, et le travail d'objectivité assidue d'un James Natchwey reste dans l'air du temps, tant il paraît légitime d'interroger l'absurde en le brandissant.
Or, les mains tordues, les corps concassés, l'effilement froid des pelles à tracteurs débordant d'ossements, quel humanisme défendent-ils a contrario ? L'inhumain peut-il produire de l'humain ? Ne peut-on risquer l'hypothèse que seule une approche chaude, un regard avec, une esthétique qui décentre l'homme et propose une espérance répondraient plus justement au désarroi grandissant de nos contemporains ? Faut-il continuer dans la même direction que les média, ou résister au mal par une conviction, une force, une ferveur ?
Nous privilégions aujourd'hui l'état de choc permanent, la complaisance atroce du Journal de 20 heures pour tout ce qui dépasse l'entendement, l’effroi considéré comme le fin du fin d'une conscience moderne.
La modernité se mesure-t-elle à la puissance du hurlement de terreur ?
Les photographies de James Natchwey n'introduisent rien sous nos yeux que nous ne sachions déjà: une image d'horreur ne nous apprend d'ailleurs rien, elle nous prend d'assaut.
Elle flatte le charognard qui dormait en nous, avide désormais de passer d'image en image vers la plus horrible, la plus émouvante, celle qui le liquéfiera enfin. Une image choquante n'explique rien, elle n'entend rien, elle ne stimule pas la pensée mais le nerf optique et la rate. Bref, l'image, on le sait, se dissocie totalement de l'éthique; le procès est d'ailleurs connu, depuis longtemps répertorié, des photographes qu'on accuse de complaisance : il va de soi qu'il fallait des prises de vue des camps de concentration. Mais l'usage de ces clichés ne doit-il pas faire l'objet de la plus grande prudence ? Ne devait-on pas entourer ces clichés de réflexions, de critiques, qui auraient stimulé l'esprit plutôt que laissé les spectateurs en proie à la magie émotionnelle et aux mâchoires de l'indignation perpétuelle ? Que la BnF propose, en son sein même, une galerie consacrée aux barbaries (un homme brûlé vif dans une cage d'escalier, une morgue improvisée en pleine campagne, des squelettes à fleur de terre) sans mettre à notre disposition les outils d'une compréhension, d'une intelligence, laissant le flou s'installer, revient à nier l’esprit, à donner une vision incomplète, voire mutilante, de la réalité.
Une jambe, un bras, une tête: voilà que nous rentrons dans une vaste empathie floue, qui ne se rapproche en rien d'une compassion active et lucide.
Une image d'horreur n'interroge personne, elle le cloue. Une image de mort remplit la conscience et, en boucle, produit fixité de l'esprit et béance du corps. Tout est vide en-dehors d'elle.
L'interrogation humanisante nécessite une mise à l'écart, comme un deuil (c'est d'ailleurs toute la différence entre mourir et crever) un climat particulier de chaleur et de respect, un sentiment bien différent de l'écrasement, de l'atterrement que provoque sans faillir le spectacle cru, déshumanisé, ordurier, de l'horreur.
Nous nous trouvons en face du plus grand mensonge moderne qui soit, celui qui tente la communion d'esprit en-dehors de l'esprit, et souhaite rassembler les hommes par le dehors, par le simple spectacle des corps. La pensée verbalisée n'est plus retenue comme vecteur principal d'humanisation. Ainsi, on réclame aux spectateurs l'attention qu'ils devraient porter à autrui en dressant le portrait en pied de tel ou tel homme, et en imposant le recours à son image comme unique vecteur de sa compréhension. Or ce poids objectif de l'horreur du monde est une imposture puiqu'il nous fait, à nouveau, envisager l'horreur par le dehors et non par le dedans; seules les spiritualités, les cultures du verbe prennent l'homme par la source, source identifiable, interrogeable, modifiable, uniquement par le Verbe et non par l'Image.
Le sentiment d'impuissance qui naît de l'horreur objective telle qu'elle est présentée par nos journaux, nos télévisions, nos films, le prouve : nous croyons ne rien pouvoir, parce que cette objectivité nous assomme au lieu de nous réveiller. Elle nous indigne stérilement au lieu de nous inciter.
La fascination d'une foule n'a jamais produit rien de bon.
Ce malheur universel dont Natchwey, sans audace autre qu'un courage de reporter, écrit une page supplémentaire (mais non pas nouvelle), ce malheur universel est un mythe: seul le lien humain, concret, le face-à-face, le soutien à un malade (et non à tous les malades de la terre) sont réels. Les autres sensations, produites par les cultivateurs du malaise, sont suffisamment troublantes pour qu'on ne les porte pas au rang d'oeuvres d'art. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur ce qui sépare cette galerie d'horreurs de Natchwey du Guernica de Picasso: c'est le même écart entre les catacombes qui flattent notre flair inné pour ce qui s'éviscère et se putréfie, et une chapelle ardente.

Bibliographie très sommaire
Article de l'Humanité:
http://www.humanite.presse.fr/journal/2002-11-30/2002-11-30-214819
Sur l'exposition de la BnF, un point de vue radicalement opposé:
http://www.artelio.org/art.php3?id_article=59
Le site officiel du photographe:
La publicité faite autour de Natchwey jusque dans les écoles de journalisme:
http://libris.grenet.fr/journalpes/article.php3?id_article=343
C.L
